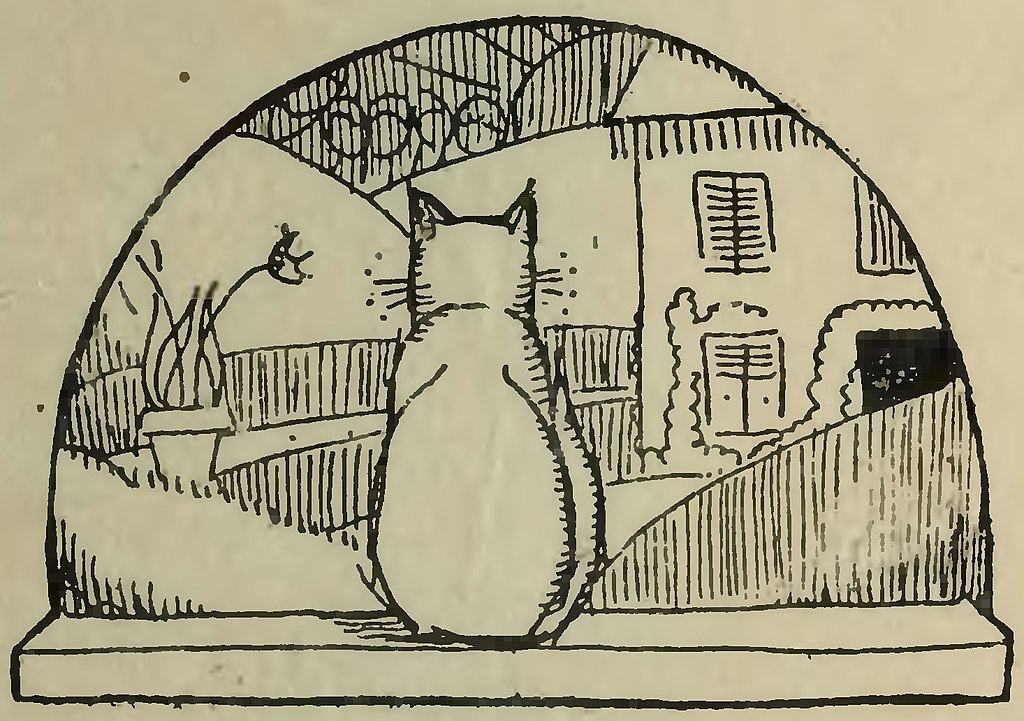De sœur à sœur (Mireille Havet et moi)
Un jour, j’ai entendu son nom. Mireille Havet. La radio l’a recraché sans que je ne me rappelle réellement pourquoi. Un nom qui n’évoque rien à personne et qui désigne celle qui a écrit qu’il fallait « Aller droit à l’enfer, par le chemin même qui le fait oublier. » (Journal 1919-1924). Née en 1898 à Médan dans les Yvelines, elle mourra avant d’atteindre ses trente-quatre ans dans un sanatorium [3] de Montana en Suisse, dévorée par la tuberculose et la toxicomanie.

En 1907, sa famille déménage à Paris, ville dans laquelle elle passera la majorité de sa vie. Son père meurs en 1913 alors qu’il est interné pour des problèmes psychiatriques. Toute sa vie, l’autrice sera suivie par la peur d’être elle aussi, sujette à des troubles psychiatriques. La disparition du patriarche familial lui offre une grande liberté dans son éducation et dans l’affirmation de son homosexualité.
Elle rédige très tôt des poèmes, des textes en prose et un journal intime qu’elle commence en mars 1913 à l’occasion d’une opération de l’appendicite et qu’elle tient jusqu’en 1929.
Après avoir été renvoyée du collège Sévigné (en raison de ses écrits et de son homosexualité), elle rencontre Apollinaire qui jouera un rôle de mentor à partir d’avril 1913. C’est ce dernier qui publie son conte fantastique La Maison dans l’œil du chat dans Les Soirées de Paris en 1913. Ce texte, ainsi que d’autres poèmes en prose, écrits à 14 ans, sont publiés en 1917 par les éditions Crès. Cela la propulse dans l’intelligentzia parisienne littéraire : de Colette à Jean Cocteau, en passant par André Gide et les premiers surréalistes. La mort d’Apollinaire en 1918, des suites de la grippe espagnole, marquera profondément la jeune femme qui ne cessera d’écrire à propos du drame qu’a été la Grande Guerre en ce qui concerne les pertes humaines.
Durant 14-18, Mireille Havet se réfugie dans sa maison familiale du Colombier. Mais elle revient vite à Paris où elle vivra une vie dissolue marquée par la pauvreté, la drogue (opium, puis cocaïne et morphine à la fin de sa vie) et les escapades dans le Sud.
Elle meurt à l’âge de 33 ans de délabrement physique dû à la tuberculose et à la toxicomanie, abandonnée de ses amis et de sa famille.
« Ma noyade est bien différente. Ma noyade est sur une autre échelle. Elle gardera toujours ce paradoxe étincelant, cette parade de l’intelligence et du contradictoire, ce scandale extérieur et qui se moque des badauds ».
(Journal du 28 septembre 1919)
Suite à quelques recherches, j’ai été percutée par la force de frappe de ses mots. Nous avons le même âge au moment du récit. Je pars m’installer dans le ventre parisien après avoir grandi en « province », comme l’a fait la diariste en 1907, suite à son enfance à Auteuil. Nous vivons toutes les deux dans le souvenir récent d’un amour qui nous a quitté pour Venise. Enfin, elle comme moi, avons une affinité handicapante avec ce qu’elle appelle « la noce » et ce que j’appelle « les soirées ». Et nous aimons les femmes. Alors que je suis engluée dans un monde paralysé par la pandémie et par la crise économique qui frappe la jeunesse de plein fouet, Mireille Havet tente d’exister dans la dure période de l’entre-deux guerres. Elle dialogue avec les mort-e-s. Et moi, j’ai l’impression de dialoguer avec une sœur.
La poétesse s’est approprié le mythe surfait du génie incompris, de l’albatros et du spleen baudelairien. Mais elle était autre chose : une femme, lesbienne, et qui écrivait à ce sujet. En effet, presque personne ne se souvient d’elle. Aujourd’hui, son amitié avec Cocteau et Apollinaire est l’une des informations la plus fréquemment référencée à son sujet. Anecdote tristement ironique quand on sait combien cette surdouée de la littérature était émancipée de toute tutelle masculine. Y a-t-il un espace pour les récits de désir féminin ? Celui de Mireille Havet a été violemment fauché par les Années folles et la drogue. Cet article, que j’ai commencé en juin 2021 durant le mois des fiertés LGBTI+, est une tentative de dialogue avec une artiste qui continue de marquer mes années de jeune adulte.
La confection de l’intime : « Au travail, Poète, Écrivain fainéant » (Vendredi 7 juillet 1922)
C’était l’été de mes 20 ans. Presque 40° C en Italie. L’atonie perçait les fenêtres et il y avait trop de bouteilles vides dans ma chambre. J’ai demandé qu’on m’offre le volume 1919-1924 du journal de cette Mireille. Peut-être parce que grandir dans une petite ville où l’on cache son homosexualité creuse quelque chose en soi. Nous n’avons que des miettes de témoignages réels. L’espace de la parole est investi par les représentations déformées de ceux qui n’ont jamais connu la moiteur d’un bar où s’entassent les gens « comme nous » qui, en réalité, ne nous ressemblent pas. Je commence à lire son journal à Toulon, dans la région du Midi. Une région qu’ont beaucoup visitée Mireille Havet et sa compagne Marcelle Garros [4], notamment de 1920 à 1921. Fraîchement rentrée d’Italie, je traîne dans ces rues où a vécu mon grand-père après avoir fui l’Algérie et je me raccroche aux mots pour traverser cette période de transition. Le soir à la plage, ambiance langoureuse. Tout le monde s’enlace aveuglement. C’est l’été 2020. On tente d’oublier les quatre mois de confinement et l’absence de perspectives.
Le journal commence comme ça :
« Mercredi 10 septembre 1919. Et voici le dernier été de toute ma première jeunesse, le dernier été de mon irresponsabilité d’enfant. 21 ans à l’automne, et je prends rang dans la foule où les sexes seuls différencient les lois jusqu’à la vieillesse. Ah ! Que de tristesse en moi pour toutes ces heures manquées, qui fuient réellement comme du sable, dans mes doigts inaptes. J’ai l’âge des plages et des jeux, l’âge où les vacances sont encore des vacances ! Et non point une oisiveté ! Une station mondaine. J’aurais pu, cette année encore et cette année seulement, vivre comme un collégien, vivre avec mes membres libres et sans trop de combinaisons cérébrales. »
Alors que le seul roman de la diariste, Carnaval (1922) [5] avait été applaudi par la critique, la jeune femme ne produira rien de plus. Pourtant issue d’une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle, elle a rencontré durant son enfance des proches de Rimbaud tels que Paul Demény et Georges Izambard. Amie avec Apollinaire qui l’appelait sa “petite poyétesse”, elle ne cessera d’être en contact avec de nombreux artistes comme l’autrice lesbienne Renée Vivien. C’est Colette, qui préfacera son premier recueil de nouvelles en 1917 ; La Maison dans l’oeil du chat. Elle aussi aimait les femmes. Mais elle a été contrainte d’écrire ses premiers romans [6] sous le nom de Willy, son premier mari, avant de pouvoir utiliser le sien et avant d’avoir la reconnaissance qu’elle mérite.
Malgré l’absence de l’œuvre qu’elle aurait dû écrire, comme beaucoup de femmes, Mireille Havet s’est confiée à un journal. Incroyablement dense. Douloureux. Vivant. Qui rend la respiration difficile. Un journal divisé en 17 cahiers, rédigés quotidiennement de 1913 à 1929, de l’aube de ses quinze ans jusqu’à son arrivée dans la trentaine. La pulsion de mort de la jeune fille se débat à travers les feuillets qui offrent une vision extrêmement détaillée du Paris lesbien de l’entre-deux-guerres. Mireille Havet n’a pas rédigé ces introspections quotidiennes dans le but de les publier. Mais, en 1995, Dominique Tiry, la petite-fille de l’exécutrice testamentaire de Mireille Havet [7], trouve ces documents dans le grenier de la maison familiale. En 2003, l’éditrice Claire Paulhan se lance dans la publication en plusieurs tomes de cette œuvre immense. Elle explique à Eli Flory en 2007 [8], que suite à la découverte du journal, Dominique Tiry « commence à plonger là-dedans et n’en sort plus. Là-dessus, elle a un grave accident de santé, elle est hospitalisée pendant trois mois. Alors qu’elle est dans le coma et qu’elle ne reconnaît ni son mari ni ses filles, elle ne cesse de dire : « Il faut que je continue à lire Mireille Havet ». Elle sort par miracle du coma, sans que les médecins n’aient identifié son mal ». Comme l’écrit sa biographe Emmanuelle Retaillaud-Bajac dans un article [9] : « Si les journaux intimes constituent, depuis longtemps, une source de choix pour l’histoire de la vie privée, et plus encore des sexualités, il est très rare, pour ne pas dire sans précédent, de débusquer ex nihilo un texte de cette ampleur et de cette qualité, offrant des aperçus aussi riches que variés sur l’intimité d’une jeune femme, pour une époque où,malgré le cliché de la « dissolution des mœurs », l’écriture de l’intime, et plus encore de la vie sexuelle, s’effectue encore sur un mode feutré, voire caché. L’exhumation du journal de Mireille Havet apparaît donc comme un temps fort dans l’historiographie française des sexualités, offrant une multitude d’approches et d’usages dont la découverte ne fait que commencer. »
Au-delà de sa valeur historiographique qui s’inscrit dans la tradition de l’écriture de l’intime, le texte présente d’indéniables qualités littéraires.
Et moi, j’ai toujours entassé mes cahiers ridicules couverts de pensées anecdotiques. Je vois tout le travail que la poyétesse a engendré et je repense aux colères innommables de mes huit ans. Je ne comprenais pas encore ma bisexualité. Je ne comprenais pas le rapport que j’entretenais avec l’une de mes camarades de classe. Ce que je savais, c’est qu’il y avait quelque chose là-dedans qui dérangeait les autres. J’avais huit ans et j’étais élevée à la chape froide du harcèlement qui ne s’explique pas. À la honte, qu’on ingère parce « qu’on est comme on est » et qu’il ne faut pas qu’on soit comme ça. Tenir un journal, c’est construire l’espace clandestin de la colère. Le même que celui dont Mireille Havet s’est emparé durant quinze ans. Le journal intime est considéré comme un genre bâtard dans le Panthéon littéraire. Appendice de celles et ceux qui auront toujours plus de difficulté à prendre la parole publiquement. On voudrait que certaines personnes ne prononcent jamais le mot « je ». Sa formulation s’apparente à un dernier acte de résistance contre la violence envers soi-même.
Les paradoxes de l’invertie : « Je ressentais une joie mêlée à un tel orgueil de faire crier et jouir cette femme si pliée, si apte, si expérimentée à toutes les voluptés, à tous les vices, à toutes les possessions ! » (Journal, 25 juin 1919)
Au moment où j’écris ça, je suis assise dans un parc où je garde une enfant pour pouvoir vivre à Paris. J’entends une femme parler à mes côtés : « Elle m’a dit qu’elle était lesbienne. Je m’en fous tant que tu fais de mal à personne. Après... si ça avait été ma fille, ça aurait été différent. » Mon dos se tasse un peu plus contre le mur de béton. Je me cache. Est-ce qu’elle va comprendre ? C’est exactement la même peur que lorsque je suis en entretien d’embauche ou que je cherche un appartement. Malgré l’amour, le militantisme et la joie de l’auto-affirmation, je supporte les contradictions de celle qui ne slalome pas assez correctement dans les normes sociales. Contradictions qui ressortent avec force dans l’œuvre de Mireille Havet. Toute la première partie de sa vie, la jeune femme énonce son homosexualité comme naturelle et source répétée de jouissance en affirmant : « Toute femme m’attire parce que nos chairs fraternisent d’avance » [10] et en écrivant fièrement « je n’ai pas troqué ma vie contre le désir d’un homme qui paie » (Journal, 28 septembre 1919). Dès 1917, quelques années avant la mode des garçonnes, elle choisit de se couper les cheveux très courts, affirmant son identité à l’intersection de la subversion et du classicisme petit bourgeois. Mais en 1923, c’est pourtant bien elle qui écrit à une amie « Être inverti n’est pas plus drôle que d’être borgne ou manchot ». Comme l’explique sa biographe Emanuelle Retaillaud Bajac, dans un article [11] :
« Le mariage demeurait, pour une jeune fille de sa génération, un horizon quasi indépassable, avec lequel il n’était pas aisé de rompre. À plusieurs reprises, et jusqu’à la fin de sa vie, elle envisagea ainsi des mariages blancs avec certains de ses amis, qui, à défaut de la ramener dans l’idéal conjugal, auraient pu lui épargner la précarité matérielle et l’opprobre sociale, à laquelle elle devait se révéler de plus en plus sensible.
[…] L’exemplarité de la trajectoire de Mireille Havet tient peut-être en ceci que la jeune femme fut moins victime d’un rejet extérieur que d’une intériorisation inconsciente, et jamais éradiquée, de cet ordre, qui la conduisirent insidieusement à se penser comme une marginale, puis une anormale et enfin « un monstre ». Sa trajectoire souligne aussi la nécessité de prendre en compte, dans l’analyse des constructions identitaires homosexuelles et de leur efficacité sociale, les enjeux « de classe », c’est-à-dire sociaux, professionnels et financiers : une des causes fondamentale de la fragilité identitaire de Mireille Havet fut son absence de fortune et d’ancrage social fort, qui rendit le « mythe lesbien » dont elle s’était armé à l’adolescence autrement plus friable que les convictions des grands bourgeois ou aristocrates homosexuel-le-s qu’elle avait fréquentés, d’André Gide à Jean Cocteau, en passant par Natalie Barney ou Romaine Brooks. » [12]

Grandir dans la brèche : « Notre génération n’est plus une génération, mais ce qui reste [...] Nous n’aimons pas fonder, construire, résoudre. Nous aimons tout ce qui finit et tout ce qui meurt. » (Journal, septembre-octobre 1922)
« Je le dis sincèrement, j’ai des périodes de lucidité douloureuse comme un malade, dans sa fièvre, s’aperçoit à ses moments d’accalmie du danger qui le menace et de la maladie qu’il subit. Ma maladie est grave, hélas, puisqu’elle est celle de ma volonté, de mon intelligence qui s’en va, presque à vingt ans, en pleine montée, elle est celle de ma déchéance consciente, voulue… un suicide ? […] « c’est un renoncement pour la vulgarité ! C’est l’amour de la laideur, c’est un vice » […] Un vice ! Celui de la déchéance, celui des compagnies inférieures, celui de la banalité. […] Mais je sais et je vois clair encore. Un mot avant de mourir, à la page déjà contaminée par ma folie, par mon ostentation de la débauche. » (Journal)
Assez vite, elle énerve. Tout meurt dans l’incapacité d’écrire, d’aimer vraiment, de se dépasser. Il y a trop de mots, et ils sont tous pris dans la torpeur de l’opium et des nuits sans sommeil qui se répètent-répètent-répètent-répètent. On est en colère de voir tout ce potentiel et de savoir que ces bribes de vie, douloureusement honnêtes, n’ont été finalement qu’un rapport égotique et sourd à soi-même. Cadeau empoisonné de mes 20 ans qui me rappelle ma crise subjective actuelle, similaire à celle de l’ensemble de la jeunesse. Un mal générationnel toujours aussi latent au XXIème siècle. Les symptômes dépressifs et les comportements addictifs ne cessent d’augmenter, les deux n’étant que des conséquences de la vie au sein de la société capitaliste régie par la mise en concurrence et le profit. La production marchande étend son emprise sur l’ensemble des sphères de l’existence. Le « désenchantement du monde » décrit par Max Weber est l’expression du mécanisme de « réification » propre à la société capitaliste, qui transforme toute chose, toute relation, tout être en bien échangeable. La réalité même de la vie semble s’évanouir et l’étouffement est universel ; tout sonne creux et faux.
Un mercredi 1er octobre 1919, cette Mireille écrivait : « L’amour n’est pour moi qu’une humiliation solitaire. L’amour, c’est l’avenue des Champs-Elysées remontée à sept heures, en pensant « où aller ». C’est la Concorde l’après-midi, où je divague entre les limousines et les taxis, « où aller ». […]
Camarades ! Les plus bêtes et les plus bas et les plus ivres, ni votre bêtise, ni votre vulgarité, ni votre caresse n’égaleront jamais celle de mon cœur.
Je suis la plus ivre de tous, et je peux rire, et parler, et danser, car tout se vaut. Mon abandon et votre déchéance sont des puits où la chute est fatale au même degré. Se tenir sur la margelle, se déchirer les ongles à la poulie.
Autant boire d’un coup l’eau profonde, et la tête la première.
Allons donc. »
Je te parle, ma poétesse. Je te dis « Je ne suis pas comme toi ! Je ne veux pas d’un rire bâtard volé au présent ! » Pourtant, moi-même je ne sais pas ce que l’on pourrait avoir de plus. À un passant qui te raccompagnait dans la foule le 1er novembre 1918 et qui te demandait « Mademoiselle , comment pouvez-vous être seule un si beau jour ? » tu répondais, « que voulez-vous, monsieur, mes amis furent tous tués ». Les ami-e-s mais aussi la foi dans le futur et dans ses espoirs. C’est toute une jeunesse mutilée qui est projetée contre le pavé de la grande industrialisation. La jeunesse qui a vécu 14-18, l’effondrement de l’économie mondiale en 1929 et la montée du nazisme dans les années 30.
Je me rappelle les premiers jours de confinement en mars 2020. La colère sourde de subir la gestion erratique du gouvernement qui nous laisse mourir en ne donnant aucun moyen aux services publics. Celle de savoir que le patronat licencie à tour de bras à cause de la fermeture des lieux. Fin mars 2020, 550 000 intérimaires ont été arrêté-e-s, tout comme des dizaines de milliers de salarié-e-s en CDD et une quantité impossible à chiffrer de travailleur-euse-s sans contrats. Parmi chacune de ces catégories, on compte une grande proportion de jeunes (la part des CDD dans les nouveaux embauché-e-s était de 87% en 2017, et en 2013, la moitié des intérimaires avait moins de 30 ans) [13]. Les travailleuses et travailleurs qui sont en première ligne de la production n’ont et n’auront aucune sécurité matérielle et sanitaire. Je me rappelle mon angoisse, due à la montée de la répression policière pendant les périodes de restriction. Selon un article publié par Rebellyon [14], entre le 8 et le 15 avril 2020, 5 personnes sont mortes après avoir croisé le chemin de la police. « Trois autres ont été blessées gravement et 7 ont porté plainte pour violences policières ». Toutes et tous projeté-e-s dans une énième crise du capitalisme qui sacrifie les subjectivités.
Mars 2020 : 20 ans et enfermée chez mes parents. J’essaie de candidater dans un master à Paris. Je ne sais plus trop pourquoi je fais cela. J’ai été sélectionnée pour le master mais l’université n’a finalement jamais ouvert durant l’année 2021. En janvier, alors qu’une vague de suicide traversait la communauté étudiante, la ministre annonçait que la crise était due aux « soirées covid » de la jeunesse et aux « bonbons que les étudiants laissent traîner sur la table ». Le pacte méritocratique continue de s’étioler. On ne peut rien nous offrir mise à part le soulagement direct et partiel de la consommation quotidienne d’alcool ou de stupéfiants. Le Monde écrivait en 2008 [15] : « Comme l’explique Laure Murat dans sa préface, le volume "1924-1927" du journal de Mireille Havet est le récit d’un naufrage, l’histoire d’une chute. Sous le signe d’une trilogie : drogue, sexe, mort. Plutôt banale en ces temps de l’après-Grande Guerre. Mais ces "années folles" avec « toutes ces images devenues les chromos d’une époque bruyante et festive masquent mal une autre réalité", écrit-elle. Ce sont des "années noires, des années de vertige, où l’on meurt de vouloir s’évader, dans l’alcool, les stupéfiants ou la folie. »

La réalité de Mireille Havet est un écho à la mienne et à celle de tant d’autres personnes invisibles. Dans ses errances et dans ses sursauts existentiels, produits d’un système capitaliste qui ne peut subsister que sur l’alternance entre crises structurelles et périodes de prospérité. Pendant les crises, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sacrifiées : les prolétaires, les LGBTI+, les personnes racisées, les handicapé-e-s. Un jour, j’ai entendu son nom. Mireille Havet. La radio l’a recraché sans que je ne me rappelle réellement pourquoi. Un nom qui n’évoque rien à personne et qui désigne celle qui, chaque jour, s’est assise pour écrire sur elle car personne ne l’aurait fait à sa place. Cent ans après, je te rencontre et tu m’accompagnes comme quelqu’un-e qui m’impressionne, mais à qui j’espère ne jamais ressembler. Tu voulais t’inscrire dans les pas de Rimbaud mais ce n’est pas ton maître. Tu t’es enfantée seule, dans la fierté ombrageuse de celles qui n’ont rien. Dans l’analyse de tes paradoxes merveilleux, tu as engendré un embryon de révolution intime, que tu nous as légué et qui continue de battre dans nos mains tremblantes.
« Vie d’acrobate que la mienne, entre la mort et la poésie suspendue, retenue par un fil toujours, et un fil d’araignée qui fait peur plus d’une fois à ceux qui me regardent », (Journal, 1926).
Zoé Picard